"L’Enfant comète" : la vie et l’œuvre éclair du jeune poète juif Hanus Hachenburg
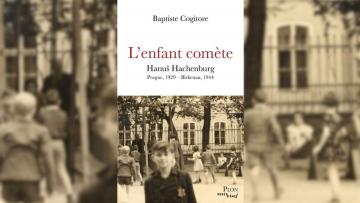

L’Enfant comète est à la fois le récit d’une (en)quête, l’histoire d’une vie, l’apologie d’une œuvre et un hommage aux victimes de l’Holocauste. L’entreprise fut colossale pour l’auteur, Baptiste Cogitore, qui a passé plus de dix années à rechercher les traces d’une existence quasi oubliée, celle de l’écrivain prodige Hanus Hachenburg, assassiné à l’âge de 15 ans à Auschwitz-Birkenau.
Baptiste Cogitore maîtrise l’art de la composition. D’emblée, les trois exergues résument à elles seules la position ambiguë (impossible ?) de l’auteur face à son sujet : bien qu’exceptionnellement documenté, vérifié, attesté, le récit de son enquête n’atteindra jamais la pure vérité. Il parvient néanmoins, par sa recherche et par l’écriture, à créer un lien par-delà l’absence et l’oubli. "Quand on parle des morts, les morts nous écoutent", disait Robert Badinter. L’auteur-narrateur s’adresse tout au long du livre à son personnage fantôme et ce dialogue unilatéral crée une impression de proximité. L’auteur-enquêteur met en scène son entreprise littéraire avec beaucoup d’humilité et de prudence. Il honore ce jeune poète disparu en parcourant à son tour les différents lieux de sa courte existence – Prague, Terezin, Auschwitz1 – pour reconstruire avec une scrupuleuse exigence l’histoire de sa vie tout en l’ancrant dans le présent : "Quant à ta réputation, comme ta mémoire, j’espère continuer à l’édifier, moellon par moellon, avec mes propres mots en guise de mortier. Tu aurais aimé l’odeur de la brume froide et du charbon brûlé, le ciel de ce matin de septembre sur Terezin, quand nous enregistrions le son de la ville sur les hauteurs des remparts pour raconter votre histoire dans un film2. […] Tu aurais aimé voir la vie revenue au ghetto3. (98)
Pour faire vivre les morts, il faut continuer de parler d’eux en essayant d’être fidèle à ce qu’ils furent. La difficulté, en ce qui concerne Hanus Hachenburg, c’est que les traces tangibles de sa courte existence sont rares. Seuls quelques-uns de ses textes écrits entre février 1943 et décembre 1943 ont été conservés aux archives du Mémorial de Terezin. La découverte de ce trésor par la dramaturge Claire Audhuy est d’ailleurs le point de départ de cette enquête au long cours qui se déclinera sous de multiples formes artistiques4. L’Enfant comète, pour son auteur, est comme l’aboutissement d’un cycle. Le livre condense un peu toutes les phases de cette aventure à la foi littéraire, spirituelle et de vie. En voici l’histoire…
Hanus Hachenburg, jeune juif originaire de Prague, confié à 9 ans à l’orphelinat par sa mère, devient écrivain à l’âge de 14 ans. Enfermé dans la "ville-prison" de Terezin, dans l’actuelle République Tchèque, l’adolescent se découvre alors poète. C’est pour lui le seul moyen de faire face aux réalités de ce ghetto mis en place par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Theresienstadt (en allemand) était un camp de transit pour les Juifs tchèques déportés vers les centres de mise à mort, un camp de travail qui servait la propagande allemande en camouflant la nature réelle de sa fonction. Une "ville-mensonge aux mille masques" (63), dont l’auteur n’oublie pas de rappeler sans cesse les réalités immondes dans une écriture scénaristique à la forte puissance évocatrice : "les greniers où l’on entasse les vieillards", "les morts chargés comme des bûches" (120), les départs incessants des convois vers les camps de la mort, la peur et la menace de voir apparaître son nom sur les listes de transport.
C’est au cœur de cet enfer que naît Vedem, le journal clandestin créé par les jeunes de la Chambrée n° 1 installée dans l’ancienne école de la ville, des "garçons très talentueux. Des camarades pour qui la poésie, l’écriture et les livres avaient de l’importance" (81). Dans ce bâtiment, les enfants de moins de 16 ans ne vivent pas avec leurs parents mais avec des "madrichim", des éducateurs, parmi lesquels figure Eisinger. Cet homme offre aux adolescents dont il s’occupe la liberté de se gouverner eux-mêmes. Ce groupe de jeunes déportés crée alors la République de Skid5, une "république de footballeurs et de poètes" (93), qui redonne à ses membres un espace de dignité, d’imagination et de création : "Désormais, les garçons […] ne sont plus des enfants juifs déportés dans un ghetto suintant la misère, la famine et la mort, mais les frères d’un territoire libre, les citoyens d’une république autonome et autogérée." (93) Vedem devient "le cœur vivant" (100) de cette chambrée, le lieu d’expression d’un "tourbillon de créativité, d’humour et d’intelligence" (101). Hanus en est le principal rédacteur et tient une place à part dans l’histoire de ce journal. Il y publie non seulement des poèmes, mais aussi des essais, des nouvelles, des critiques et une pièce de théâtre. Il "explore les styles, les registres et les formes" (136) au travers d’une production dont la puissance, l’exigence et la maturité sont sidérantes au regard de son jeune âge ! Mais Hanus Hachenburg n’est déjà plus un enfant…
Jadis, j’étais un enfant… il y a deux ans de cela ;
cette enfance aspirait à d’autres mondes.
Je ne suis plus un enfant : j’ai vu la pourpre,
à présent, je suis un adulte ; j’ai appris à connaître la
mort,
ce mot sanglant et ce jour gâché.
Ce n’est plus simplement le croque-mitaine !
Baptiste Cogitore ponctue son récit d’extraits des textes du jeune poète. Un mouvement de va-et-vient s’instaure entre l’histoire de sa vie, marquée par le traumatisme inaugural de l’abandon maternel, et ses écrits. Sa voix résonne et inscrit dans le texte sa présence fantomatique. Toute la construction du livre repose sur cette présence-absence qui semble habiter son auteur.
En décembre 1943, Hanus Hachenburg est déporté au camp d’Auschwitz-Birkenau. Avant d’entamer la troisième partie du livre sur les huit derniers mois de sa vie (il mourra dans les chambres à gaz en juillet 1944), Baptiste Cogitore insère dix-huit textes inédits écrits par le jeune poète dans Vedem6. La voix du narrateur s’efface alors totalement avant de réapparaître dans la dernière partie, comme pour combler le silence du jeune déporté, dont on n’a encore retrouvé aucune trace écrite sur cette période.
Dans ce récit de la vie des enfants de Theresienstadt déportés à Auschwitz apparaissent des figures historiques : Dita Klaus, la bibliothécaire d’Auschwitz, Fredy Hirsch, enseignant et sportif juif allemand, figure de proue du Kinderblock7, ou encore le terrifiant Docteur Mengele, qui scellera le destin d’Hanus Hachenburg. Des noms que l’on retrouve parfois dans la littérature sur les camps. Baptiste Cogitore s’appuie ainsi sur la richesse documentaire existante, sur les témoignages qu’il a lui-même recueillis, sur les lieux qu’il a parcourus et dont lui restent en tête les images8, et sur les textes, bien sûr, de cette œuvre éclair, dont il se fait l’exégète et le chantre : "Je t’ai cherché, surtout, dans tes écrits. J’ai plusieurs fois tenté de raconter ton histoire comme on tient un chapelet, en faisant défiler des grains de connaissances sur le fil précaire d’un récit malhabile. Des colliers d’anecdotes pour raconter ce que fut ta vie. Je t’ai cherché dans les livres des autres et jusque dans mes propres phrases. Je t’ai tant cherché, tu sais." S’il subsiste un doute en lui, celui de ne pas avoir su dire quel enfant Hanus Hachenburg était réellement, que l’auteur se rassure : il l’a, avec virtuosité, sorti de l’oubli en nous donnant à lire une œuvre et une histoire dont la puissance résonnera encore longtemps dans notre mémoire.
---
[1] Ce sont en réalité deux tours du monde que Baptiste Cogitore et sa femme, Claire Audhuy, ont effectué pour enquêter et rassembler toutes les pièces du puzzle au travers des témoignages de survivants, de chercheurs, d’archives, etc.
[2] Le Fantôme de Theresienstadt, film documentaire de Baptiste Cogitore, 52 minutes, 2019.
[3] Toutes les citations sont extraites du livre L’Enfant comète ; la page est indiquée entre parenthèses en fin de citation.
[4] Un premier recueil des textes d’Hanus Hachenburg publié en 2015 par les éditions Rodéo d’âme, la mise en scène, par Claire Audhuy, de sa pièce de théâtre On a besoin d’un fantôme, un film documentaire, une lecture musicale…
[5] L’origine de ce nom trouve sa source dans l’histoire de la révolution bolchevique (cf. p. 85-93).
[6] La pièce de théâtre On a besoin d’un fantôme, écrite par Hanus Hachenburg à Theresienstadt et dont le texte n’apparaît pas dans L’Enfant comète, a été publiée dans un autre ouvrage éponyme publié en 2015 par Baptiste Cogitore et Claire Audhuy.
[7] Autrement appelé le Block 31, l’unité qui regroupait les enfants des juifs arrivés du camp de Theresienstadt, au sein du" camp des familles".
[8] L’appareil critique du livre est extrêmement riche et instructif.











































