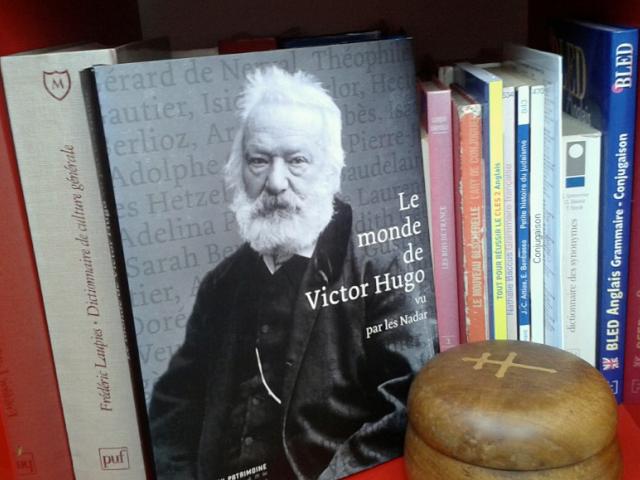La voix de Marie Gloris Bardiaux Vaïente


"Scénariste de bande dessinée, docteure en histoire, militante pour l'abolition universelle de la peine de mort et blogueuse féministe en pleine déconstruction, j'écris sur tout ce qui donne du sens à ma colère et à mon désir de comprendre le monde. Et certains soirs, quand ça ne suffit pas, je compose des poésies érotiques."
Marie Gloris Bardiaux Vaïente affiche un masque de guerrière. Pourtant, dans son jardin baigné de soleil à Marmande où elle nous a reçus, le masque s’est levé lorsqu’elle a évoqué ses lectures. Une femme pudique et fragile, habitée par le doute, s’est dessinée.
Comment se sont faites ton entrée en lecture et ta rencontre avec les livres ?
Marie Gloris : La lecture est très liée aux femmes de ma famille et à l’amour. Ma grand-mère était institutrice et m’a appris à lire alors que j’avais 5 ans. Ma mère est une grande lectrice. Savoir lire, c’était être reconnue par ma grand-mère et le gage d’être une bonne élève. Sa maison était pleine de livres et le livre est un élément essentiel dans ma relation à elle. Mais si ma grand-mère censurait certaines lectures, ma mère au contraire m’a mis entre les mains toutes sortes de livres. Très jeune, j’ai lu Boris Vian, Sartre, Annie Ernaux… Et j’avais une amie dont le père était professeur de latin-grec avec qui nous organisions des séances de lectures. Cette émulation m’a ouvert à des textes comme L’Iliade et L’Odyssée.
Mais il y a eu un texte fondateur qui a participé d’une première étape de ma construction personnelle, Antigone de Jean Anouilh. J’avais 12 ans lorsque je l’ai lu pour la première fois. J’ai éprouvé une grande tendresse pour ce personnage orgueilleux. J’ai entamé ainsi une réflexion sur la notion de justice, réflexion que j’ai continué à avoir tout au long de ma vie. C’est un texte qui me suit de près, que je lis une fois par an, dans toutes les versions que je trouve et que je vais voir régulièrement au théâtre. La version d’Anouilh reste celle que je préfère parce que c’est la première que j’ai lue. La justice est fondamentale pour moi, mais c’est très complexe. À 23 ans, j’ai été jurée d’Assises. Cela a été une étape, comme ma première lecture d’Antigone.
Tu écris des fictions historiques, et sur des sujets de société. Quel lien fais-tu entre tes études d’histoire, ton écriture et la littérature ?
M.G. : J’ai su à 14 ans que je voulais faire des études d’histoire, car j’aime comprendre les choses et avoir du recul sur comment elles sont arrivées. En 2011, j’ai rencontré Robert Badinter au sujet de ma thèse et il m’a demandé pourquoi je réalisais ce travail. Je lui ai simplement répondu « parce que j’ai besoin de comprendre». Comprendre comment l’espace européen est de droit le seul espace dans le monde où la peine de mort est interdite. J’aime également la généalogie. Jeune adulte, je construisais les arbres des Rois de France et faisait les liens entre eux et les différentes familles d’Europe.
J’ai fait des choix dans ma vie, mais la construction est antérieure et nourrie de l’histoire de mes parents, eux-mêmes nourris par l’histoire de leurs parents et ainsi de suite. L’Histoire est sans fin et elle n’est jamais objective. Si nous ne pouvons pas tricher avec les sources, l’interprétation reste propre à chaque chercheur.
C’est également vers l’âge de 13 ans que j’ai découvert le travail de l’écrivaine Annie Ernaux. La sociologie autobiographique qu’elle utilise me donne envie d’aller vers ce genre d’écriture. Tous les auteurs parlent d’eux et se cachent derrière la fiction. Je ne suis pas sûre que cela m’intéresse. Et puis, cela signifie écrire sans masque et se livrer complètement ; je ne suis pas sûre non plus d’y arriver.
Écrire l’Histoire, c’est quelque chose de technique où je réunis les pièces du puzzle. L’écriture a quelque chose de psychanalytique pour moi. La responsabilité des auteurs qui écrivent sur "les autres" est immense alors que les "autres" n’ont rien demandé. Je ne suis pas sûre d’y trouver mon compte, j’ai besoin d’être dans une parole frontale, que mon côté militant puisse exister. Or, être militant, c’est mettre sa pudeur de côté.
Quel est ton rapport au dessin en tant que scénariste de bande dessinée et en tant que lectrice ?
M.G. : Enfant puis adolescente, je ne dessinais pas, je me l’interdisais. Ma mère dessine et peint très bien, cela ne pouvait donc pas être mon domaine, je ne pouvais pas y toucher. Il y a six mois, je m’y suis pourtant mise, je me suis autorisé le droit de dessiner malgré un gros complexe. Entamer cette démarche vers le dessin est un passage vers l’émancipation et cela m’ouvre des perspectives personnelles. J’affine mon regard, j’intègre le temps que cela demande et j’accepte que le rendu ne soit pas ce que j’espérais. Ma seule ambition est d’oser le faire.
Dans mon travail de scénariste de bande dessinée, le masque est là : le dessinateur dessine sur ce que j’écris, il s’approprie le texte. J’ai une grande admiration pour les artistes-plasticiens. Je suis fascinée par leur réinterprétation de ce que j’écris. L’étape suivante serait de ne plus avoir besoin de me cacher derrière le dessin des autres.
Ma culture d’enfant et d’adolescente sur la bande dessinée vient de mon père. Comme mes parents sont séparés, j’avais deux espaces de lecture différents. Je consacrais mon argent de poche à l’achat de Pif. Pour ma mère, les bandes dessinées n’étaient pas des livres, certainement parce que c’est un univers qu’elle ne connaît pas. Mais elle lit ce que j’écris. C’est une reconnaissance. Enfant, j’allais à la bibliothèque toutes les semaines et j’empruntais des bandes dessinées. Les romans, eux, étaient achetés en librairie. Petite, je voulais être maîtresse, avocate, journaliste et scénariste. J’ai réalisé que j’avais réuni ces quatre métiers par les choses que j’ai réalisées et le dessin y a une grande place.
Maîtresse d’école, féministe, comment l’écriture et la littérature interviennent dans ces engagements forts ?
M.G. : Maître d’école est un métier qui a un côté narcissique. Tu es un demi-dieu dans les yeux de tes élèves parce que tu as le savoir et que c’est un pouvoir. J’ai choisi ce métier pour pouvoir transmettre quelque chose à mon échelle, mais aussi recevoir par les interrogations que me renvoient les enfants. Cela rejoint le militantisme. J’ai décidé de quitter l’enseignement. Les contraintes de l’Éducation nationale sont très pesantes et je ne me sentais plus à ma place. Quand j’ai commencé ce métier, j’ai su que je ne le ferai pas toute ma vie, mais que ce serait le moteur d’autre chose. À 34 ans, j’ai renoué avec mes études, car je m’ennuyai intellectuellement, et c’est à cette période que j’ai commencé à écrire des bandes dessinées. Il a fallu que je devienne docteure pour assumer d’être une intellectuelle, mais je ne m’attache pas encore le terme d’artiste. Écrire sur l’Histoire est très confortable, c’est un socle sur lequel je peux m’appuyer et c’est un domaine dans lequel je suis reconnue.
J’aimerais explorer par l’écriture la sexualité, interroger ce qu’est être une femme. Le féminisme est très évolutif chez moi. Ma réflexion est permanente, elle va de la colère à la profondeur de qui je suis. Elle est très liée à Antigone. Elle est seule face à des hommes et tente de faire entendre sa voix.
À 12 ans, ma mère m’avait écrit un mot qui disait : "Tu seras un homme, ma fille." Il signifiait que je ne devais pas m’empêcher de faire des choses identifiées comme étant du domaine des hommes. C’est vrai que j’aime les choses qui sont plutôt du monde masculin : la politique, la bande dessinée, l’aviation. En un sens, cette phrase est fausse, mais je comprends l’intention, être à égalité de traitement. Pour moi, le système patriarcal est un ennemi. Mon côté guerrier est assez puissant, ce qui n’empêche pas que je me pose sans arrêt des questions. Je dirais que toute lecture de fiction ou autre m’a nourrie, tous les livres m’apportent et il en est de même pour le cinéma.
King Kong Théorie de Virginie Despentes a été un choc féministe. Assumer le féminisme peut être compliqué. C’est un terme militant, qu’il faut assumer, qui signifie "foncer dans le tas". Je ne veux plus me censurer, ne plus craindre de ne plus être aimée. J’ai compris qu’on ne peut pas vouloir prêcher tout en craignant de déplaire.
L’enfance est quelque chose de spécial. J’ai toujours eu horreur de Peter Pan ou d’Alice au pays des Merveilles. Je n’ai aucune nostalgie de l’enfance. J’ai été une enfant, mais sans en avoir le sentiment. J’ai été responsabilisée très tôt, j’évoluais dans des assemblées d’adultes lors desquelles je lisais ou j’écoutais. Je me suis nourrie de leurs paroles et les romans jeunesse que je lisais étaient sur des thèmes très durs. Mon métier d’enseignante m’a fait redécouvrir la littérature jeunesse. J’ai alors simplement acheté les livres qui me plaisaient.

Lucie Braud alias Catmalou est née en 1975 à Bordeaux où elle a vécu plus de vingt ans. Elle navigue entre la bande dessinée, le roman, le récit, l’album jeunesse, la lecture à voix haute. Ses territoires de création de prédilection explorent l’enfance et le portrait. Elle travaille seule ou avec les dessinateurs Alfred, Édith, Cromwell, Joseph Lacroix et l’illustratrice Lauranne Quentric.