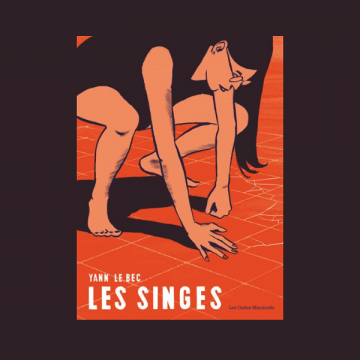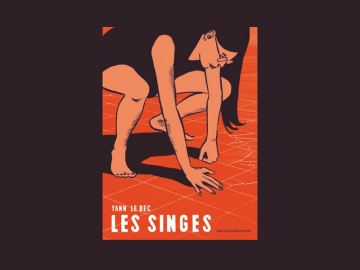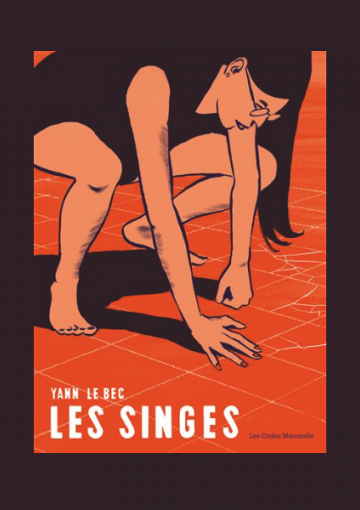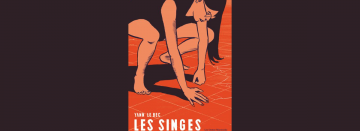Thomas Gosselin, chercheur de contraintes fertiles


Thomas Gosselin est un auteur de bande dessinée complet et prolifique. À Montreuil, où il vit, il partage un atelier avec des dessinateurs et des cinéastes. Au Chalet Mauriac, où il a séjourné en juin 2025 en tant que lauréat BD, c’est une ambiance similaire qu’il retrouve, mais dans un autre rapport au temps. Il exploite cette parenthèse pour travailler sur différents projets et dans l’idée de se confronter à des contraintes pour stimuler et renouveler sa créativité.
À l’origine, sur quel projet êtes-vous venu travailler au Chalet Mauriac ?
Thomas Gosselin : Il s’agit d’un projet que j’ai intitulé Sainte-Brigitte et les Troubles. J’y parle de l’Irlande du Nord à l’époque de son combat pour l’indépendance. C’est un mélange de faits politiques et de légendes irlandaises dans lequel j’apporte une pointe de fantaisie humoristique pour contrebalancer l’aspect dramatique. La mythologie est sans cesse présente autour des personnages et je m’inspire des contes pour construire l’écriture.
Sainte-Brigitte est une figure sainte qui est remise en avant car elle incarne un visage féministe en Irlande. Elle est connue pour avoir pratiqué le premier avortement. Elle était bonne sœur et dans son couvent, l’une des sœurs est tombée enceinte. Sainte-Brigitte a fait disparaître l’enfant en apposant ses mains sur le ventre de la femme. Elle a été également à l’origine de la fondation d’une grande ville, Kildare. Ce n’est pas pour autant une histoire religieuse que je vais raconter.
D’où vient le désir d’écrire cette histoire ?
Thomas Gosselin : Ma mère est Irlandaise, pas du Nord certes, mais elle m’a raconté de nombreuses légendes venues de ce pays. Je reviens d’une certaine façon un peu sur l’histoire familiale. Mais je ne voulais pas écrire un récit trop grave ou trop sérieux. Mon intérêt pour les contes et les légendes a fait que j’ai voulu les réactualiser parce que je trouve qu’ils sont encore très adaptés à notre monde contemporain. J’aime le principe des histoires qui nous racontent comment le monde s’est formé ou comment l’Homme s’est construit.
De quelle façon travaillez-vous sur ce projet ? Quelles sont vos intentions narratives ?
Thomas Gosselin : Je m’occupe essentiellement de l’écriture car j’ai proposé à un dessinateur, Sébastien Chrisostome, de travailler avec moi. Le projet évolue au fur et à mesure de l’écriture. Tout commence par trois valises échangées, trois valises identiques contenant un objet particulier. Je travaille de façon linéaire sur le story-board, je reviens un peu sur la structure initiale. À partir de l’histoire de ces trois valises, je cherche une raison scénaristique. J’écris comme un feuilleton pour voir où cela me mène. Parfois, c’est un personnage qui raconte quelque chose et en parallèle, un autre récit qui se déroule, comme celui d’une falaise par exemple où l’on voit d’un côté les personnages qui la gravissent, et en parallèle on suit l’origine mythique de cette falaise.
Mon souhait est de surprendre le lecteur, qu’il accepte de ne pas tout comprendre. Je veux le troubler, l’amener vers une folie douce à travers ces expériences de pensée et de rêverie, une sorte de voyage psychédélique. J’ai terminé l’écriture mais j’y reviens avec le dessin. Le plus souvent, je simplifie car j’ai tendance à être bavard, ou quand le dessin raconte ce qui n’a plus besoin d’être dit, cela me permet de faire des coupes dans le scénario. Ce sera un roman graphique assez imposant – environ cent cinquante pages – car Sébastien Chrisostome utilise beaucoup l’espace. Au départ, j’ai été assez surpris de sa proposition graphique, d’autant qu’il est entré dans l’univers en n’ayant aucune indication précise, mais avec seulement un résumé de l’histoire et une vingtaine de pages de scénario. Et il a fini par me convaincre.
Sur ce temps de résidence, vous concentrez-vous uniquement sur ce projet ou cela vous permet-il de travailler en parallèle sur autre chose ?
Thomas Gosselin : Pour Sainte-Brigitte et les Troubles, c’est vrai que mon travail actuel consiste à réajuster l’écriture en fonction du dessin de Sébastien et cela me laisse le temps de penser à autre chose. En réalité, je travaille sur deux autres projets en même temps.
Le premier projet s’intitule pour l’instant Hagiographies enragées. J’écris et dessine des biographies élogieuses très courtes sur des artistes que je connais dans le monde de la bande dessinée. Je fais cela avec beaucoup de flagornerie et d’humour. Chaque histoire tient sur une page et il est possible de les lire sans avoir besoin de connaître la personne concernée. J’en ai écrit une soixantaine et je suis en train de les dessiner. C’est un recueil surtout qui met en scène mes obsessions. Il y a des répétitions entre les récits, j’utilise un certain vocabulaire de façon récurrente, je suis dans l’excès, le superlatif. J’ai commencé ce travail car j’étais très énervé contre plein de monde et j’ai eu envie de faire quelque chose sur les gens que j’aime. En arrivant au Chalet, j’avais écrit une douzaine de textes. C’est une écriture récréative dans laquelle je m’amuse à dessiner en tout petit et rapidement, ce qui n’est pas dans mon habitude. Je me suis imposé des contraintes donc j’ai fait tout le découpage, j’ai posé les textes et je dessine seulement dans la place qui me reste. C’est une façon de travailler propre à ce projet.
Le deuxième projet est expérimental, je l’ai intitulé Notre livre de S.-F. Je travaille non pas sur une bande dessinée mais sur des colonnes dessinées et deux récits se déroulent en parallèle : un roman de science-fiction dans la colonne de gauche, une bande dessinée qui n’a rien à voir avec ce roman dans la colonne de droite. Il n’y a pas de lien direct entre les deux histoires, mais il y a des liens indirects qui se forment au fur et à mesure. Le roman est écrit et je travaille sur la partie dessinée lors de la résidence. Je cherche à ce que ce soit lisible comme un webtoon, par une lecture verticale, je veux voir si cela fonctionne. Je suis parti d’une forme expérimentée par Jacques Derrida, dans son essai philosophique Glas dans lequel il entremêle deux textes sur deux colonnes. Dans mon projet, je me rends compte que le temps ne passe pas de la même façon dans le roman et dans la bande dessinée, donc je travaille sur des images pleines de détails sur lesquelles le lecteur aura besoin de s’attarder. J’ai terminé le story-board et fait en sorte que les fins des deux récits soient synchronisées. J’ai également fait en sorte qu’à un moment donné, les deux colonnes s’échangent, changent de place, car je parle de l’inversion dans les deux histoires. Je veux alors que le lecteur jongle entre les deux modes de lecture. C’est un exercice plaisant dans le travail de création, que ce soit par les mots ou par le dessin, qui me fait partir vers le délire et choisir des routes bizarres. Il y a certes une différence entre les mots et le dessin, mais je ne sais pas vraiment où elle se situe.
En quoi ce temps de résidence enrichit-il votre travail ?
Thomas Gosselin : La résidence m’offre un temps que je n’ai pas souvent, et encore moins depuis que j’ai un enfant. La dernière que j’ai faite date d’il y a neuf ans. C’est important d’avoir ce temps mais c’est aussi très bizarre car je dois déconstruire mon rapport au temps pour le reconstruire au sein du Chalet. C’est comme une parenthèse en dehors de la vie familiale qui a son propre rythme.
La résidence au Chalet, c’est aussi la possibilité de rencontrer d’autres gens qui ont d’autres obsessions que les miennes, d’autres passions, qui travaillent sur d’autres thèmes. Et des gens qui ont envie de faire connaissance avec d’autres. Les deux cinéastes qui sont en ce moment même en résidence avec moi font des choses très différentes de mon travail et ils ont d’autres problèmes. En bande dessinée, il y a moins d’argent en jeu que dans le cinéma et cela change le rapport au projet. Ils se posent d’autres questions relatives à leurs contraintes. C’est très enrichissant d’en parler avec eux, de s’intéresser aux solutions que les autres trouvent face à leurs contraintes. Chercher des contraintes, c’est ce qui m’intéresse dans l’exercice de création, des contraintes fertiles. Et nous échangeons sur des films, des livres. Il y a une émulation, un partage, une découverte. Au Chalet, nous n’avons rien d’autre à faire que travailler, manger, nous balader, échanger. Ici, il se crée un décalage et c’est ce que je suis venu chercher. Alors je travaille tant que je peux, je lis, je me promène, je me nourris.