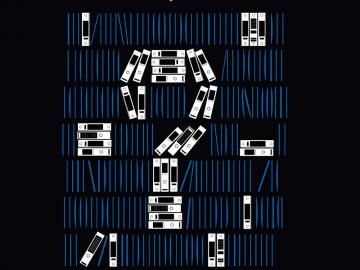"Les Dossiers bleus", un film documentaire pour comprendre et rendre publics les cas de torture au Pays basque espagnol
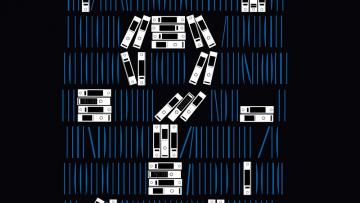

En 2022, le cinéaste Ander Iriarte a réalisé un documentaire sur le rapport du "Projet de recherche sur la torture et les mauvais traitements au Pays basque entre 1960 et 2014", mené par l’Institut basque de criminologie. Le titre, Karpeta urdinak (Les Dossiers bleus), fait référence à la couleur des cinq mille dossiers de cas de torture officiellement reconnus au Pays basque. Entretien avec le réalisateur Ander Iriarte.
---
Quelle est l’origine de votre film sur la pratique de la torture au Pays basque espagnol ?
Ander Iriarte : Dans le cadre du processus de paix au Pays basque, le gouvernement de la communauté autonome a demandé à l’Institut basque de criminologie de réaliser une étude indépendante sur l’incidence de la torture sur le territoire. Bien qu’ayant un passé familial et amical où la torture a existé, je n’avais jamais imaginé l’ampleur révélée par l’étude. Une fois le rapport publié, je pensais qu’il provoquerait un émoi dans la société, mais le gouvernement basque l’a simplement laissé au fond d’un tiroir. C’est sans doute en partie à cause des chiffres élevés concernant la torture pratiquée par la police autonome basque elle-même. Indigné, j’ai décidé de réaliser le documentaire, de rendre visibles les résultats du rapport et d’aider les gens à comprendre ce qu’est la torture en général et sa réalité au Pays basque.
La réalisation du documentaire a-t-elle rencontré une forme de censure ?
Ander Iriarte : Je distingue deux types de censure : celle d’un État autoritaire, qui empêche ouvertement la liberté d’expression, et celle, plus insidieuse, qui consiste à permettre la réalisation de recherches ou de films, mais sans y contribuer, afin d’en parler le moins possible. Cette deuxième forme pousse à la pire des censures : l’autocensure. Par exemple, lorsqu’un auteur ou un chercheur omet ou déguise des informations afin d’obtenir un soutien financier ou une plus grande visibilité. Dans notre cas, le fait de mettre en lumière les données impliquant la police basque nous a coûté le soutien de la télévision régionale, qui n’a pas financé le projet.
Pourquoi est-il si difficile de faire entendre les témoignages des victimes ?
Ander Iriarte : La principale façon de discréditer les témoignages est de prétendre que les cas de torture sont des fabrications de l’ETA (Euskadi ta Askatasuna) visant à affaiblir l’État espagnol. Aux yeux du grand public, la torture devient alors une stratégie de déstabilisation, une simple propagande politique, ce qui provoque un rejet de la parole des victimes, jugées non crédibles. Par ailleurs, de nombreuses victimes ne parlent pas. D’une part, elles considèrent que leur expérience ne correspond pas à ce qu’elles imaginent être la "vraie torture" — parce qu’elles ne sont pas mortes ou parce qu’il n’y a pas eu, par exemple, usage d’électrochocs. D’autre part, beaucoup craignent de ne pas être prises au sérieux ou de subir de nouvelles représailles, ce qui s’est déjà produit, la police s’étant assurée que cela se sache. Le traumatisme de la violence subie et la honte des humiliations empêchent également la libération de la parole.
Quel est le protocole pour démontrer scientifiquement les cas de torture ?
Ander Iriarte : À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme rend la torture illégale. Cela pousse les tortionnaires à éviter de laisser des traces physiques. Dès lors, la "torture psychologique" se développe, visant à faire souffrir l’esprit jusqu’à briser la victime, provoquant une souffrance physique insoutenable. L’adjectif "psychologique" masque le fait que la personne torturée est écrasée par un traumatisme accablant, à la fois corporel et mental. C’est pourquoi, depuis 1999, le protocole d’Istanbul a été mis en place. Il permet aux médecins et autres spécialistes d’évaluer et de témoigner en faveur des victimes présumées, même des années après les faits.
Karpeta urdinak filme tout le processus, afin de faire "valider l’invisible" par des experts. Il s’agit de montrer comment un témoignage peut être transformé en preuve, même quarante ans après. Les sociétés disposent donc de protocoles reconnus pour prouver les délits de torture. Cependant, leur application dépend souvent du même système politique que celui ayant commis ces forfaits, ce qui les rend inefficaces : aucun gouvernement ne va s’auto-incriminer pour des crimes contre l’humanité.
Votre documentaire est-il parvenu à changer le regard sur la torture au Pays basque ?
Ander Iriarte : Nous avons relayé les résultats de l’enquête : entre 1964 et 2014, vingt mille cas de torture ont eu lieu au Pays basque, dont cinq mille ont été officiellement reconnus, mais seulement vingt cas ont été établis judiciairement avec les nom et prénom de la personne torturée. Dans le film, l’usage des archives permet de confirmer les témoignages des victimes via une approche statistique. Les preuves réunies auprès des médecins et des témoins ont permis de démontrer que les récits de torture ne sont pas subjectifs. Un juge n’a pas le pouvoir, à lui seul, de prouver les cas de torture, mais avec la masse de documents accumulés, la vérité a commencé à s’imposer dans la société basque — et au-delà. Il revient maintenant aux citoyens de s’emparer du film, qui est devenu un véritable symbole pour la population. Sur les réseaux sociaux, dans les festivals, l’accueil a été extrêmement positif. À chaque projection où l’équipe était présente, des personnes venaient en pleurs nous remercier d’avoir fait éclater la vérité au grand jour. Ce film est une catharsis pour les victimes et pour une partie de la société. Grâce à un large mouvement citoyen, j’espère que la divulgation de cette vérité cachée conduira à des mesures de réparation pour les victimes.