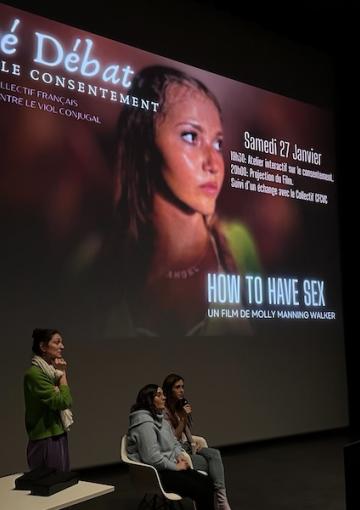S'en-paysager, réflexion autour de la relation entre paysages et littérature


De quels chemins, de quelles montagnes, de quels fleuves l’écriture est-elle parcourue ? Et quels espaces poétiques permet-elle de tisser pour (ré)habiter nos paysages ? Les visages de nos territoires, familiers ou fantasmés, sont, tour à tour, appréhendés, redessinés, ré-investis en convoquant les sens, dans leurs œuvres respectives, par des auteurices contemporain.e.s de Nouvelle-Aquitaine, et/ou venus en résidence d’écriture dans cette région. Tour d’horizon de leurs façons d’appréhender le vivant par l’écriture.
Laurence De La Fuente, écrivaine et metteure en scène, Frédéric Dumond, auteur et artiste, Romuald Giulivo, écrivain, Pascale Moisset, autrice pour la jeunesse et Lydie Palaric, artiste et autrice, ont en commun de s’inscrire dans une écriture du vivant. La rencontre se produit autour de l’interaction qui s’opère entre leurs géographies intérieure et extérieure pour entrer en littérature. Éminemment sensorielle, elle a lieu autour du feu avec FEU !, album jeunesse de Pascale Moisset1 et Le sens du vent de Lydie Palaric et Benoît Cary2, en référence aux feux de forêt survenus en 2022 en Gironde, de l’eau avec Espaces aquaphoniques pour Laurence De La Fuente3 et L’île d’elles pour Romuald Giulivo4, des langues, enfin, pour Frédéric Dumond. Quel mécanisme est à l’œuvre dans le "lieu" et comment le geste de création le lit-il, le vit-il, le traverse-t-il ? Les responsables des maisons de résidence d’auteurices du grand Ouest de la France, dédiées tout particulièrement aux questions d’écriture et de paysage, Mélanie Archambaud pour la Villa Valmont à Lormont, et Jérémy Fabre pour la Maison Julien Gracq à Mauges-sur-Loire, ainsi que Camille Prunet, maîtresse de conférences en théorie de l'art à l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui a récemment dirigé l’ouvrage Paysages sensibles. Art et Écologie5, se joignent à nous pour interroger cette notion de "paysage" et saisir ce qu’elle veut dire de nous et de notre rapport au monde.
"Penser les paysages, c’est envisager différents aspects d’un espace délimité visuellement (donc subjectivement) : à la fois écosystème vivant ; territoire vécu, investi et habité par des humains ; représentations esthétiques de cet espace ; émotions et sensibilités qu’il suscite. Un paysage en recouvre donc toujours plusieurs6."
Dans le sillon de Julien Gracq, émanation française d’une littérature du vivant
S’il existe un genre littéraire né aux États-Unis en sensibilité avec le vivant, du nom de nature writing (écrire sur la nature), qui remonte à Henry David Thoreau, il existe aussi des exemples dans la littérature française d’un intérêt pour le paysage, non pas en tant que décors mais en tant qu’éléments actifs dans le récit.
C’est le cas de Julien Gracq dont le rapport au lieu et au paysage, ainsi qu’au voyage dans le lieu, dans la géographie, constituent l’une des signatures de son œuvre et de son écriture. Chez lui, les sensations viennent du paysage et étoffent l’humeur des protagonistes, le paysage devient un personnage en tant que tel. Jérémy Fabre, directeur de la Maison Julien Gracq, précise qu’il n’y a peut-être pas un élément géographique qui est constitutif de l'œuvre de Gracq, mais que la Loire, au pied de la fenêtre, l'est forcément de par son passage et de par ce paysage très mouvant puisqu’elle ne s'arrête jamais.
Avec sa formation première de géographe, il se caractérise par une certaine sensibilité et déjà une intuition concernant cette interaction entre humain et environnement. Bien que non reconnu comme auteur du vivant ou du paysage, il évoque déjà, 50 ans avant même qu’on commence à parler d’anthropocène, la fin des bocages et donne le nom de "quaternaire historique" à l’impact irréversible de l’humain sur notre biodiversité ou géodiversité dans la revue de Georges Bataille, en 1947.
Julien Gracq ouvre, en un sens, la voie à toute une nouvelle génération d’auteurices qui se réclament plus d’une appartenance à une littérature de la géographie ou du lieu, des territoires où le vivant s’écrit et se transpose dans cette rencontre entre paysages intime et extérieur.
Romuald Giulivo, écrivain, qui se réfère à cet héritage littéraire, aime, à travers ses mots, déployer une géographie inventée, de la sensation. Dans L’île d’elles, il travaille l’image mentale des îles éoliennes par petites touches, à partir de positions, de sentiments pour faire naître des images chez les lecteurices, sans jamais leur imposer un paysage par la description, et rester dans la suggestion. Pour lui, la façon dont on raconte l’histoire, c’est avant tout une circulation.
Nous avons tourné le dos au port et j’ai imité mon frère. Je me suis mis torse nu et j’ai scruté le paysage. Nous avons dépassé les ateliers abandonnés, nous avons laissé derrière nous les bassins à flot, les grues, le portique de levage, puis viré vers le sud. La ville et les chantiers et le monde ont disparu, effacés, engloutis par les montagnes et la végétation. Depuis le large, j’étais prêt à concéder une certaine beauté à ce caillou de misère où, à dix-huit ans, j’avais déjà perdu trop de temps. Nous fendions les flots et il n’y avait plus que l’ocre des falaises, les colonies de figuiers accrochés aux parois abruptes, les bosquets d’hibiscus, les bougainvillées et les eaux bleu cobalt et le volcan coiffé d’épaisses fumerolles7.
Pascale Moisset, autrice pour la jeunesse, précise, quant à elle, que si le paysage renvoie de prime abord à une notion d’esthétique, c’est quelque chose qui n’est jamais figé, mais dans le ressenti. L’écriture induit, selon elle, une perspective : cadrer, zoomer, sentir le vent, et c’est une façon de prolonger des sensations par-delà le lieu. Pour l’autrice, l’écriture se situe dans le registre du vivant : ça vit et ça la fait vivre. Comme elle aime à le dire : quand j’écris, j’y suis.
…
Une pomme de pin explose en feu d’artifice.
Sauve qui peut !
Gare à mes oreilles et ma queue.
Et la libellule ? Que fait-elle de ses ailes ?
Des flammes bondissent des bosquets,
à grandes enjambées,
tourbillonnent en anges danseurs.
Surtout ne pas se laisser ensorceler
par leur ronde maléfique.
Trop tard !
Le dragon déboule.
Il embrase toute la forêt.
Les pins culbutent.
C’est le chaos ! Je suis cerné.8
…
Le paysage comme "présence au monde"9 ?
Parler aujourd’hui de "paysages" engage désormais de prêter une agentivité au paysage. Camille Prunet, théoricienne de l’art, a choisi la terminologie de "paysages sensibles" car elle évoque la crise de la sensibilité qui nous affecte tou.te.s. Elle rappelle que le déclin de la biodiversité ne se produit pas qu'à l'échelle des êtres vivants. Il est aussi à l'échelle individuelle, psychologique, mentale et peut engendrer des formes de détachement au monde. Aussi, le livre, comme les arts visuels, ambitionnent de (re)travailler avec ses attachements et de donner envie aux autres de se (re)connecter à une forme de sensibilité.
C’est ce qui est à l’œuvre chez Frédéric Dumond, auteur et artiste qui se définit comme un "capteur sensoriel". Avant d’entrer en écriture, il se laisse "traverser" en travaillant au sol plutôt qu’assis, à un bureau. Il entretient cet état lors de l’écriture pour cesser d’être dans un rapport anthropocentré : être, selon ses termes, une porosité au dire du vivant, des vivants, des non-vivants, être avec le "lieu" plutôt qu’avec le "paysage" pour s’y fondre.
Cette relation au paysage s’opère, chez lui, grâce aux langues qui lui permettent d’être "en présence", il n’en écrit pas moins de 141. Par les entrées et sorties qu’il opère à différents endroits de ses poèmes, avec ses mots et ses sonorités pluriels, Frédéric Dumond permet de revenir au microscopique et d’accéder à une échelle de territoire, de vie. Par ce mouvement, l’auteur favorise le lien, une forme de reconnexion chez les lecteurices qui sont projeté.e.s, la plupart du temps, dans un rapport extérieur, lointain au paysage, avec les "hyper-objets", du nom donné par Timothy Morton aux microplastiques ou au réchauffement climatique.
l’homme et la femme xii ko nchrii
l’enfant l’enfant l’enfant xiichjan nchrichjan ko xiichjan
creusent un trou ngengan xan naa thue
maintenant il y a un trou
anchee jii naa thue
l’enfant la femme l’enfant l’enfant l’homme parlent nchrichjan nchrii xichjan
xichjan xii nichja na nichja na
toute la langue entre dans la terre nguixin tha dixi’in ngain nunthe
ils bouchent le trou et plantent une pitahaya tejanthe na thue ko nthjenga na naa nthaxechjian
la langue est là tha yaa jii la lengua
cachée dans la terre jima ngado’o nunthe
ils partent bachjre
la femme au centre nchrii jii ngusine
l’homme à l’est xii jii nuthi dachrjexin ncha’on
l’enfant à l’ouest xichjan jii nuthi detaunxin
l’enfant au nord nchrichjan jii nuku’e
l’enfant au sud xichjan jii nununthe
la pitahaya grandit ils oublient la langue
nthaxechjian dangi rutjaña’a ra tha
la langue attend ja tha ruchu’en si
avec la pitahaya ngajin nthaxechjian10
Laurence De La Fuente, écrivaine et metteure en scène, partage parfois aussi ce sentiment de devenir "lieu" comme Frédéric Dumond. Elle ressent cette forme de "contamination" de l’écriture, selon ses mots, par les territoires qu’elle investit puis parcourt autrement grâce au geste de création. C’est d’ailleurs l’écriture qui lui permet de trouver sa place, même temporaire, dans ces endroits. Pour Espaces aquaphoniques, elle cherche, avec des onomatopées liquides, sonores, à percuter le texte qui évoque la sécheresse, la crue, toujours en lien avec le lieu où elle écrit.
Jusqu’au mitan du vingtième siècle
il était fréquent de nager en rivière
En eau vive
Sur la Seine des piscines installées
Des cabines de bain flottantes
Des guinguettes
Des barques
Des parties de campagne
Des plages de sable près de Melun
Des villas balnéaires
le long des fleuves
et des rivières
La trace d’un paysage
d’habitus disparus
oubliés
engloutis
effacés11
Voir des entremêlements, des attachements, les nourrir grâce à l’art : la photographie et désormais l’écriture, c’est ce que Lydie Palaric, artiste et autrice, envisage, à travers ses deux activités, en prenant appui sur l'histoire des paysages, ses contes et légendes, ses particularités industrielles ou ses qualités environnementales.
Pour l’autrice, il n’y a pas de différences entre ces deux médiums : elle produit des photographies en série, comme des phrases, et voit des images quand elle écrit. Avec Le sens du vent, elle évacue par le biais de l'écriture, l'émotionnel et le trauma, pour être en mesure de "mieux voir" le nouveau paysage qui l’entourait et apprécier le travail photographique de Benoît Cary qui a rejoint le projet, dans un second temps.
"Je regarde le sens du vent. Plusieurs fois par jour, je m’informe de la direction que prend le feu. Il est d’une telle puissance qu’il génère son propre vent, complètement imprévisible. Il terrorise même les pompiers incapables de prévoir ce qu’il va faire. Il prend vie et se dirige seul, surprenant tout le monde, changeant de sens, puis tournoyant. Il est intelligent, il a sa propre force, comme s’il était doté d’une conscience, élaborant lui-même des stratégies les plus sournoises. Celui que nous appelons "le monstre" ne se laisse pas faire, il réplique, il se bat, il a incontestablement le dessus. Il est guidé par quelque chose qui nous dépasse"12
La littérature constitue une façon de garder une trace, constituer une mémoire pour pouvoir continuer à habiter. Lydie Palaric rappelle que pendant les feux, la solidarité dans son quartier de Belin-Béliet était quotidienne mais que la plupart sont aujourd’hui passé.e.s à autre chose et ne souhaitent pas/plus aborder ce sujet.
Aussi, pour Lydie Palaric, comme pour Camille Prunet, c’est essentiel de continuer à produire dans le contexte actuel des bouleversements écologiques. Travailler les singularités, les "biodiversités de chacun.e" comme les appelle Camille Prunet, c’est une façon de mettre en mouvement les gens, de leur faire sentir qu'il manque quelque chose dans leur environnement qui s'appauvrit peu à peu. Si Lydie Palaric exprime une forme de préoccupation, après avoir vécu les feux suivis d’une replantation hâtive des pins au même endroit, et s’interroge sur la capacité des Occidentaux à accéder à une forme d’horizontalité, présente dans d’autres sociétés, Camille Prunet rappelle qu’il faut accepter que ce que l'on produit n'ait pas une efficacité immédiate.
D’où la nécessité de ces lieux dédiés à la littérature et au paysage tels que la Villa Valmont et la Maison Julien Gracq qui offrent aux auteurices itinérant.e.s des espaces-temps propices à l’observation, au dialogue autour des paysages à travers différentes approches artistiques, scientifiques et à l’écriture.
Mélanie Archambaud qui dirige la Villa Valmont, lieu qui dédie un de ses appels à projets aux "Résidences paysages", précise que le lieu de résidence n’a pas tant vocation à créer de nouveaux paysages qu’à créer de nouvelles manières de les dire, de les lire, de les appréhender en décentrant le regard, et peut-être, à terme, d'agir au sein de ces paysages-là. Pour elle, la Villa Valmont est, avant tout, un "poste d’observation" à la fois du Parc des Coteaux et aussi des milieux urbains qu’on n’observe plus.
Alors, écrire pour changer de paradigme ? Se repositionner dans le geste de création, et inviter les lecteurices à faire de même ? Ou écrire pour vivre le paysage, créer des mondes poétiques où pouvoir habiter ? Peut-être, écrire pour s’en-paysager, et retrouver le goût d’être vivant.
---
1. Illustrations d’Yves Viallard, éditions courtes et longues, parution le 28 mai 2025.
2. Aux éditions de l’Entre-deux-Mers.
3. En écriture, produit en partie en résidence à la Villa Valmont.
4. Aux éditions Anne Carrière.
5. Aux éditions Eterotopia.
6. Camille Prunet, Paysages sensibles. Art et Écologie, éditions Eterotopia, p.9.
7. Romuald Giulivo, L’île d’elles, éditions Anne Carrière.
8.Pascale Moisset, FEU !, illustrations d’Yves Viallard, éditions courtes et longues, parution le 28 mai 2025.
9. Terminologie employée par Frédéric Dumond.
10. Extrait d’un texte en territoire ngigua de Frédéric Dumond, en cours d’écriture, entamé lors de sa résidence à la Villa Valmont, en mars 2025.
11. Extrait d’Espaces aquaphoniques de Laurence De La Fuente, en cours d’écriture, entamé lors de sa résidence à la Villa Valmont.
12. Lydie Palaric et Benoit Cary, Le sens du vent, Les Éditions de l’Entre-deux-Mers.